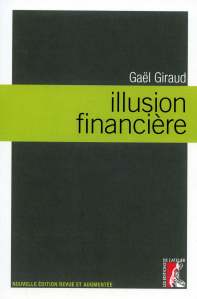 L’économiste Gaël Giraud, membre de la Congrégation des Jésuites (sic), a fait reparaître au printemps dernier son ouvrage intitulé Illusion financière (Ivry-sur-Seine : Les Éditions de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, 2013). Comme son titre ne l’indique pas vraiment, le but de l’auteur n’est autre de proposer des pistes pour sortir de la financiarisation actuelle de l’économie: la finance contemporaine constitue en effet selon lui une illusion de création de richesse et d’efficacité économique dont il faut se déprendre pour pouvoir aller vers une nouvelle croissance adaptée aux enjeux du changement climatique. Il se targue en effet de proposer un modèle de sortie de crise du capitalisme, dont aucun lecteur ne s’étonnera – vu la qualité de jésuite de l’auteur – qu’il s’apparente à un renouvellement du discours de la « troisième voie » du christianisme social entre le socialisme et le capitalisme, mâtinée désormais d’écologie. L’auteur consacre en effet de longues pages à la définition d’une « économie des biens communs » qui ne serait ni privée ni publique, mais qui se situerait dans « un ailleurs », pourtant fort reconnaissable pour un historien des idées chrétiennes des deux derniers siècles sur l’économie capitaliste (cf. le chapitre 7, « Vers une société de biens communs », p. 107-119). Pour fonder son propos, G. Giraud fait appel aux travaux désormais connus en France d’Elinor Ostrom sur l’institutionnalisation de la coopération sociale, tout en les mâtinant d’une double référence à la « règle d’or » (de la morale) et à la morale universaliste d’E. Kant. Il applique ces idées de « bien commun » prioritairement au domaine financier et bancaire, ce qui renouvelle si j’ose dire le produit tout en conservant l’essentiel. Ainsi, pour lui, la monnaie, en particulier comme « liquidité », devrait être pensée et institutionnalisée comme un « bien commun », et il faudrait idéalement obliger les banques à n’user de leur indéniable pouvoir de création monétaire que pour financer les investissements nécessaires dans la transition écologique de nos économies. Tout cela est bien beau, et ferait seulement doucement sourire si, heureusement, l’auteur n’était pas aussi un bon connaisseur des affaires financières contemporaines. Il n’est certes pas toujours d’une clarté à toute épreuve dans cet ouvrage (un peu par abus de métaphores filées et d’allusions trop rapides), mais le lecteur trouvera tout de même dans l’ouvrage une vulgarisation bienvenue des savoirs en la matière qui permettent d’éclairer la crise actuelle.
L’économiste Gaël Giraud, membre de la Congrégation des Jésuites (sic), a fait reparaître au printemps dernier son ouvrage intitulé Illusion financière (Ivry-sur-Seine : Les Éditions de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, 2013). Comme son titre ne l’indique pas vraiment, le but de l’auteur n’est autre de proposer des pistes pour sortir de la financiarisation actuelle de l’économie: la finance contemporaine constitue en effet selon lui une illusion de création de richesse et d’efficacité économique dont il faut se déprendre pour pouvoir aller vers une nouvelle croissance adaptée aux enjeux du changement climatique. Il se targue en effet de proposer un modèle de sortie de crise du capitalisme, dont aucun lecteur ne s’étonnera – vu la qualité de jésuite de l’auteur – qu’il s’apparente à un renouvellement du discours de la « troisième voie » du christianisme social entre le socialisme et le capitalisme, mâtinée désormais d’écologie. L’auteur consacre en effet de longues pages à la définition d’une « économie des biens communs » qui ne serait ni privée ni publique, mais qui se situerait dans « un ailleurs », pourtant fort reconnaissable pour un historien des idées chrétiennes des deux derniers siècles sur l’économie capitaliste (cf. le chapitre 7, « Vers une société de biens communs », p. 107-119). Pour fonder son propos, G. Giraud fait appel aux travaux désormais connus en France d’Elinor Ostrom sur l’institutionnalisation de la coopération sociale, tout en les mâtinant d’une double référence à la « règle d’or » (de la morale) et à la morale universaliste d’E. Kant. Il applique ces idées de « bien commun » prioritairement au domaine financier et bancaire, ce qui renouvelle si j’ose dire le produit tout en conservant l’essentiel. Ainsi, pour lui, la monnaie, en particulier comme « liquidité », devrait être pensée et institutionnalisée comme un « bien commun », et il faudrait idéalement obliger les banques à n’user de leur indéniable pouvoir de création monétaire que pour financer les investissements nécessaires dans la transition écologique de nos économies. Tout cela est bien beau, et ferait seulement doucement sourire si, heureusement, l’auteur n’était pas aussi un bon connaisseur des affaires financières contemporaines. Il n’est certes pas toujours d’une clarté à toute épreuve dans cet ouvrage (un peu par abus de métaphores filées et d’allusions trop rapides), mais le lecteur trouvera tout de même dans l’ouvrage une vulgarisation bienvenue des savoirs en la matière qui permettent d’éclairer la crise actuelle.
Premièrement, l’auteur ne cesse de rappeler qu’à la fois en théorie pure et en pratique (vu l’expérience faite depuis une trentaines d’années), les marchés financiers s’avèrent bien incapables d’orienter une économie vers une croissance pérenne (sans bulles spéculatives récurrentes), pour ne pas parler d’aller une croissance écologiquement soutenable. Les marchés financiers fonctionnent en effet, selon G. Giraud reprenant des thèses bien connues, selon le modèle dit des « tâches solaires », c’est à dire sur des pures croyances des opérateurs qui amènent les prix des actifs qu’on y négocie à errer au fil des marottes haussières ou baissières du moment. Pour l’auteur, ce ne peuvent donc pas être les marchés financiers qui disent vers où doit s’orienter la croissance future; ce sont les entreprises, les Etats, ou bien le débat citoyen, qui définissent – ou devraient définir – les paramètres du futur économique souhaitable (pour G. Giraud lui-même, un futur où l’on prévient le changement climatique). La remise en cause des marchés financiers comme « boule de cristal collective » qui permettrait de lire le futur par accumulation d’opinions individuelles sur ce dernier s’avère ici radicale. Ces derniers ne sont qu’une illusion de ce point de vue. Gaël Giraud consacre des pages fort bien vues à cet aspect (Chapitre 3, « Un marché financier, c’est (très in)efficace? », p.46-62). Parallèlement, G. Giraud croit tout de même déceler au fondement de la crise financière actuelle un projet politique, celle de la « société de propriétaires » (cf. chapitre 1, « La ‘société de propriétaires’, un idéal messianique? », p.13-24) En effet, qu’est-ce qui a produit la crise des « subprimes » au déclenchement de tous les désordres financiers et économiques actuels, sinon entre autres la croyance politique que tout le monde aux États-Unis pouvait (ou même devait) devenir propriétaire de son logement? Il rejoint ici les auteurs qui pointent du doigt le risque économique que les bulles immobilières, enclenchés par des financements trop faciles et au fond irresponsables de la part d’un secteur financier aussi créatif qu’euphorique, font courir à l’économie réelle, tout y ajoutant l’aspect politique de ce choix (cf. p.20-23). Bref, l’investissement et l’avenir des sociétés humaines en général sont des choses bien trop sérieuses pour être laissé ainsi aux marchés financiers.
Deuxièmement, l’auteur rappelle au lecteur que c’est bel et bien le secteur financier qui se trouve à la source de la crise économique actuelle et non les Etats (p.37-40), et que c’est ce dernier qu’il est urgent de mieux réguler (cf. chapitre 10, « Les chantiers communs prioritaires », p. 142-164). G. Giraud fait partie de ces économistes qui ne croient pas au « cadrage » de la crise européenne tel qu’il s’est imposé depuis 2010. Il décrit fort bien à quel point Etats, grandes banques et BCE sont désormais solidaires dans le désastre éventuel qui les menace, en raison de la vaste « pyramide de Ponzi » qu’ils ont bâtie ensemble pour se sortir de la crise dite des dettes publiques européennes (p. 40-44). Surtout, il souligne que les banques commerciales ne peuvent pas structurellement dire la vérité sur leur mauvaises affaires éventuelles au risque de périr dans l’instant à la fois par impossibilité d’accéder du coup au marché monétaire et par déclenchement d’un bank run à leurs guichets (p. 87 et suivantes). L’idée de ce « mensonge structurel par omission » qui frappe les grandes banques n’est sans doute pas nouvelle, mais G. Giraud l’étend aux Etats garants en dernier ressort de ces banques et aussi à la Banque centrale européenne. Personne ne peut énoncer la vérité de la situation d’une banque en difficulté, parce que c’est faire advenir le pire sur l’heure. Il faut donc mentir – ou faire semblant de ne pas voir l’évidence -, et profiter du temps gagné pour discrètement résoudre (si possible) les problèmes rencontrés. (Ce qui bien sûr tend parfois à aggraver les problèmes, comme avec les Caisses d’épargne espagnoles). Ou bien alors, jouer de l’effet de surprise (après avoir menti), c’est à dire dans un même temps, rendre public le problème rencontré et prendre les mesures draconiennes qui s’imposent (cas des banques chypriotes par exemple). Ce que propose G. Giraud, c’est en quelque sorte un raffinement de l’argument désormais bien connu du « too big too fail ». Non seulement les grandes banques universelles qui dominent l’économie européenne contemporaine ne peuvent pas faire faillite et en jouent au détriment des contribuables qui seront chargés de les sauver si nécessaire, mais en plus leurs dirigeants sont condamnés par la structure même de la situation à dire que tout va bien pour eux faute de quoi ils sombrent dans l’instant, et les régulateurs (nationaux et européens) ont tout intérêt à être le plus prudent possible dans leurs éventuelles remontrances à ces mastodontes et à faire semblant de les croire. En lisant G. Giraud, on se dit que les historiens de cette période auront fort à faire pour découvrir qui savait quoi à quel moment, et on n’est pas trop rassuré pour l’avenir : quels cadavres trainent encore dans les placards des banques? On notera qu’à quelques jours d’intervalle le Monde s’est inquiété en gros titre du sort des banques européennes et que les Echos nous ont rassuré ensuite en première page, bizarre non?
Troisièmement, notre économiste jésuite souligne, logiquement vu ce qui vient d’être dit, que la sortie de crise repose d’abord sur une remise en ordre du secteur financier. D’une part, il faut limiter la source essentielle de la spéculation sur les marchés financiers, à savoir l’appel au crédit bancaire pour la financer (« effet de levier ») – à en juger des derniers mois, cela paraît bien mal parti… D’autre part, il faut remettre les banques à l’ouvrage dans leur rôle traditionnel de financement des ménages et des entreprises – même remarque… L’auteur se déclare pour une séparation des activités de marché financier des banques et des activités liées au rôle des banques dans l’économie réelle. La réforme française en la matière lui parait l’une des plus timides du monde occidental (p.153), ce qui correspond tout à fait à la logique d’une capture du régulateur étatique français par la BNP, la SG, le Crédit agricole, etc.
Gaël Giraud s’inscrit donc parmi la (petite) cohorte de ces économistes qui récusent la pleine liberté donnée depuis quelques décennies aux banques et aux marchés financiers. Son ennemi à lui, c’est bel et bien la finance. Il souligne d’ailleurs qu’une partie des dirigeants du monde financier en tient pour un darwinisme social (certes non dit en public), qui ne peut que s’opposer frontalement aux valeurs chrétiennes (cf. p. 60-61, les propos d’un banquier anonyme, pas loin de crier haut et fort, l’éternel « salauds de pauvres! »)
En effet, ce qui distingue l’ouvrage d’autres dans le même genre, c’est que notre jésuite ne met pas son étendard moral dans sa poche, et qu’il ose aussi penser en terme de fins morales des individus. Son dernier chapitre s’intitule « Nous libérer du veau d’or » (chap. 11, p. 165-179), et il y rappelle l’engagement de l’Église catholique contre la finance telle qu’elle est devenue. Le projet qu’il cherche à définir est par ailleurs comme nous l’avons dit clairement écologiste. Il le relie à la source franscicaine de la doctrine de l’Église (p. 174-176), ce qui est évidemment plutôt bien vu… pour un jésuite par les temps qui courent.
La vraie faiblesse de l’ouvrage, comme de la plupart de ceux des économistes critiques qu’il m’a été donné de lire, c’est de proposer des pistes de changement sans (vouloir) se rendre compte des obstacles politiques à ce dernier. G. Giraud ne sous-estime pourtant pas les appuis politiques dont bénéficie le secteur financier, en particulier en France, à la fois par ses menaces, par sa proximité avec les élites administratives et par son lobbying; il ne sous-estime pas non plus le poids de l’idéologie néo-libérale qui pose les marchés financiers comme juge ultime de tout avenir possible. Il appelle dans sa conclusion, en bon chrétien social, à une mobilisation sur le sujet (p.177-178). Il n’a pas tort bien sûr, mais, en 2013, ne peut-on pas conclure que cette mobilisation n’a pas eu lieu? (et peut-être n’aura pas lieu?).
François Hollande se fait ainsi élire en mai 2012 en déclarant devant le peuple de gauche que « son ennemi, c’est la finance » (discours du Bourget, janvier 2012). Il se fait donc élire sur cette belle promesse, et la majorité de notre brave Président de faire voter en 2013 une loi bancaire qui apparaît à tous les commentateurs (pas seulement à G. Giraud) comme du très honnête et très inutile « pipi de chat » dicté par nos braves banquiers. Qu’en conclure? Peut-être simplement que, pour l’instant, les grandes banques françaises gardent la main, et que leur volonté l’emporte nettement sur toute « volonté citoyenne », du moins telle qu’elle peut être porté par le Parti socialiste au pouvoir. De fait, nous sommes en effet très loin, tout particulièrement en France, d’une indignation populaire à la mesure du coût pour le contribuable des folies de (certains) de nos banquiers. Tout de même, la folie Dexia aurait déjà coûté autour de 6,6 milliards d’euros (selon la Cour des comptes), et l’addition peut encore s’alourdir. Mais il faut bien dire que, dans les médias, de ce cas Dexia, on n’en a pas parlé à la hauteur des sommes englouties, et qu’à ma connaissance, l’opinion publique en est resté sans voix. L’opinion publique française a globalement gobé la fable selon laquelle la crise européenne est due à des méchants Etats dispendieux stipendiant des hordes de fainéants – ou, tout au moins, tout se passe comme si c’était le cas.
Bref, en cet été 2013, la conclusion est facile : les banquiers (qui ont survécu) ont tout gagné, les contribuables ont tout perdu, parce que les uns ont su se mobiliser pour leur peau, et que les autres ont un peu trop dormi (ou été endormis), ou ont confié bien à mal propos la défense de leurs intérêts. Cela peut changer, mais j’ai comme un doute.
Il est certes possible que, au prochain éclatement de bulle spéculative (dont la lecture de G. Giraud nous permet largement de prédire l’existence en raison de l’abondance des liquidités injectées dans les circuits financiers par les banques centrales, cf. p.95-96, p. 101-102), les banques qui seront prises au piège de leur propre bêtise devront cette fois-ci payer de leur disparition leurs erreurs de gestion. C’est sans doute l’enjeu des réformes autour de l’Union bancaire au niveau européen… mais imagine-t-on vraiment, mettons en 2017 ou 2018, la BNP ou la SG fermée du jour au lendemain pour leurs erreurs de gestion par des « gnomes » européens sous les applaudissements de la foule parisienne enfin réveillée de sa torpeur sans que le pouvoir politique français courre leur aide? Vedremo.

J’ai fait il y a quelque temps un billet sur Gaël Giraud:
http://pratclif.com/economy/gael-giraud/
A mon sens, ce qui manque dans cette analyse c’est une critique du système bancaire, de l’impression de monnaie et du crédit avec la complicité de l’état, sources d’inflation, de dévaluation de la monnaie, du crédit facile avec taux d’intérêt plus faible que le taux d’intérêt « naturel » (préférence de présent pour l’avenir), créateur de bulles, de mauvais investissements puis de krachs qui surviennent pour corriger ces excès.
Cordialement par cette chaleur!
Pingback: Gaël Giraud, Chef économiste à l'AFD | Sequoia Vox
Voltaire n’aimait pas beaucoup les jésuites… Mais peut-être aurait-il apprécié celui-là ?
En tout cas, il semble donc que les valeurs chrétiennes sont absentes du monde financier : « une partie des dirigeants du monde financier en tient pour un darwinisme social (certes non dit en public), qui ne peut que s’opposer frontalement aux valeurs chrétiennes ».
Pour être franc, je m’en doutais un peu… parce que si le « monde financier » était authentiquement chrétien, ça se saurait.