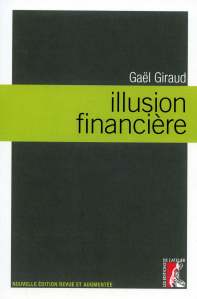Michel Aglietta s’est associé avec Thomas Brand pour produire un nouveau livre sur la crise européenne (Un New Deal pour l’Europe. Croissance, euro, compétitivité, Paris : Odile Jacob, 2013). Comme son titre l’indique, il s’agit pour les auteurs de présenter (encore une fois) une solution à la crise de la zone Euro. Bien sûr, ce n’est pas celle qui se trouve mise en œuvre actuellement. En effet, les auteurs appellent à une vaste reconversion de toute l’Union européenne vers le high tech, « le durable », « l’environnemental », ce qui représenterait une phase ultérieure de la croissance séculaire de l’Occident (cf. chapitre 6, « Quelle croissance sur l’Europe? », p. 233-289, cf. tableau 6.1, « Innovation séculaire »). A dire vrai, ce blabla mi-écolo/mi-schumpétérien m’a paru d’une insigne banalité. Oui, oui, il faut innover, oui, oui, il faut tenir compte du changement climatique qui vient, oui, oui, il faudrait peut-être penser en terme d’épuisement des ressources naturelles, oui, oui, chers docteurs Pangloss, il faudrait faire mieux qu’actuellement en terme de satisfaction des besoins humains. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que les conditions politiques (minimales) d’une telle conversion « écolo-scientiste » de tous les pays de l’Union européenne ne semblent pas prêtes d’être réunies. Malgré toutes les dénégations du présent gouvernement, le récent limogeage de Delphine Batho est là pour rappeler à tout le monde que « l’écologie, cela commence (décidément) à bien faire », et qu’il vaudrait mieux revenir aux dures réalités de la compétition internationale comme dirait le nouveau président du MEDEF. Drill, drill, baby, drill! Mais aussi qu’en dehors de l’austérité (qui bien sûr ne concerne toujours pas la France), point de salut pour les braves!
Michel Aglietta s’est associé avec Thomas Brand pour produire un nouveau livre sur la crise européenne (Un New Deal pour l’Europe. Croissance, euro, compétitivité, Paris : Odile Jacob, 2013). Comme son titre l’indique, il s’agit pour les auteurs de présenter (encore une fois) une solution à la crise de la zone Euro. Bien sûr, ce n’est pas celle qui se trouve mise en œuvre actuellement. En effet, les auteurs appellent à une vaste reconversion de toute l’Union européenne vers le high tech, « le durable », « l’environnemental », ce qui représenterait une phase ultérieure de la croissance séculaire de l’Occident (cf. chapitre 6, « Quelle croissance sur l’Europe? », p. 233-289, cf. tableau 6.1, « Innovation séculaire »). A dire vrai, ce blabla mi-écolo/mi-schumpétérien m’a paru d’une insigne banalité. Oui, oui, il faut innover, oui, oui, il faut tenir compte du changement climatique qui vient, oui, oui, il faudrait peut-être penser en terme d’épuisement des ressources naturelles, oui, oui, chers docteurs Pangloss, il faudrait faire mieux qu’actuellement en terme de satisfaction des besoins humains. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que les conditions politiques (minimales) d’une telle conversion « écolo-scientiste » de tous les pays de l’Union européenne ne semblent pas prêtes d’être réunies. Malgré toutes les dénégations du présent gouvernement, le récent limogeage de Delphine Batho est là pour rappeler à tout le monde que « l’écologie, cela commence (décidément) à bien faire », et qu’il vaudrait mieux revenir aux dures réalités de la compétition internationale comme dirait le nouveau président du MEDEF. Drill, drill, baby, drill! Mais aussi qu’en dehors de l’austérité (qui bien sûr ne concerne toujours pas la France), point de salut pour les braves!
En revanche, le livre est digne d’intérêt en ce qu’il présente un essai d’explication de la crise européenne en insistant fortement sur les interactions entre la sphère réelle et la sphère financière lié à l’existence même de l’Euro.
En effet, pour M. Aglietta et T. Brand, c’est bel et bien l’Euro tel qu’il a été conçu et géré de ses origines jusqu’à nos jours qui se trouve la cause unique (ou presque) de tous nos malheurs actuels – ce qui ne les empêche pas bien sûr de vouloir que l’aventure de l’Euro continue, et donc d’être publié en conséquence chez Odile Jacob.
Premièrement, la dérive des compétitivités entre pays de la zone Euro possède une cause au départ financière (cf. p. 54-59, p. 72-75, p. 83-93). En effet, ce sont les transferts mal avisés de capitaux du centre vers la périphérie (via les banques et les marchés financiers) qui vont y entraîner une explosion de l’endettement des acteurs économiques privés et/ou publics, avec au choix des bulles immobilières et/ou des augmentations de la consommation des ménages ou de l’État. Au lieu de financer des investissements productifs qui auraient augmenté la productivité du travail dans la périphérie (et donc sa richesse par habitant) (cf. graphique 2.4, p.74), les investisseurs sont en effet allés y placer leur argent dans l’immobilier, ou dans les banques locales qui ont permis l’augmentation du niveau de vie des ménages et de l’État par le biais de l’endettement devenu d’un coup (trop) facile (cf. graphique 2.5, p. 75). De fait, les auteurs font remarquer après bien d’autres qu’un seul taux d’intérêt directeur dans une zone économique qui comprend des pays à inflation différente implique des taux d’intérêts réels différents selon les pays (p. 175) – avec, dans certains cas, une incitation irrésistible à s’endetter. « Le coût du capital a été le plus bas lors des années 1999-2008 dans les pays où l’endettement a été le plus élevé et où la crise financière a été la plus forte » (p. 84-85) Cet afflux d’argent prêté à la périphérie implique par suite des déficits de la balance commerciale de ces pays, une inflation qui s’y accélère, et enfin une augmentation des coûts salariaux. Ces derniers, qui augmentent à la périphérie depuis 2002 alors qu’en Allemagne, Autriche et Finlande ils stagnent, finissent par mettre en danger l’existence même de l’industrie dans les pays périphériques (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce) de la zone Euro. On retrouve là les considérations sur le coût du travail dans la périphérie de la zone Euro (qui y justifient la « dévaluation interne » en cours), mais la raison de cette augmentation du coût du travail à la périphérie est ici explicitée par une mauvaise orientation des flux financiers au départ de la séquence. Bien que les auteurs n’évoquent pas le cas des pays en dehors de la zone Euro, situé dans l’ex-Europe soviétisée, ils pourraient l’ajouter à leur tableau sans changer le sens de leur récit.
Deuxièmement, toute la difficulté à sortir de la crise en Europe tient justement au fait que les dirigeants européens, surtout à partir de 2010, ont défini la crise comme une crise de la dette publique des Etats (en prenant la Grèce comme cas standard), et non comme une crise du système financier européen dans son ensemble. L‘État follement dépensier a été déclaré coupable, forcément coupable, et l’échec massif de certaines banques à orienter leurs attributions de crédit de façon à générer de la croissance durable a été minimisé, voire oublié. De fait, pour sortir vraiment de la crise, il aurait fallu d’abord apurer les énormes erreurs d’investissement faites par les banques européennes au cours des années 2000 (cf. p.133-152, p.199-216). Le projet d’« Union bancaire » a bien sûr les faveurs des auteurs, justement en ce qu’il permettrait d’apurer vraiment les erreurs du passé et d’éventuellement éviter la répétition du même scénario à l’avenir. Pour les auteurs, il ne fait guère de doute que c’est à la fois le poids politique (ou relationnel) des banquiers privés et la complexité institutionnelle d’un système bancaire transfrontalier sans superviseur unique et sans mécanismes juridiques unifiés qui ont empêché une salutaire « euthanasie des banquiers » (c’est ma propre expression). A en juger par la nouvelle loi bancaire française, on peut craindre que le poids politique du lobby bancaire reste suffisant pour empêcher des évolutions défavorables aux banques actuelles et à leurs dirigeants. De fait, puisque nous sommes en 2013 et que tout cela a commencé à être révélé en 2007 (lorsque la BNP déclare que deux de ses filiales aux États-Unis ont des difficultés), il n’est pas très difficile d’affirmer que les pays européens ont quelque peu traîné à faire le ménage dans leurs banques – même s’il ne faut pas oublier tout de même que quelques banques européennes, particulièrement imprudentes dans leurs choix, ont été restructurées à la hache au début de la crise (ce qui est la solution préconisée par les auteurs au vu de l’expérience de crises bancaires antérieures).
Troisièmement – mais là, il ne s’agit pas principalement d’aspects financiers -, la construction intellectuelle qui fonde la zone Euro ignore superbement les acquis de la « nouvelle géographie économique » (Krugman, début des années 1990) (p. 94-101). Dans un espace monétaire unifié, l’industrie tend à se renforcer et à se concentrer là où elle était déjà la plus forte, et là où les conditions institutionnelles se trouvent réunies pour avoir des rendements croissants et de l’innovation. Pour lutter contre cette polarisation, les auteurs rêvent du coup, comme je l’ai dit d’entrée, d’une Union européenne qui se mettrait à investir partout sur son vaste territoire dans le high tech, la R&D, etc., au nom d’un nouveau capitalisme verdi, en particulier dans sa périphérie. Cet argument de la polarisation industrielle de longue période sur certaines zones se trouve ici renforcé par l’idée très « régulationniste » d’arrangements « capital/travail » plus ou moins favorable à l’industrie (en particulier en Allemagne) qui parcourt tout l’ouvrage. Cette façon de raisonner insiste donc sur la « dépendance au sentier ». Elle devrait plutôt inciter les pays les plus faibles à chercher à dissoudre la zone Euro, puisque, sous de telles conditions où le passé détermine largement l’avenir, ils ne rattraperont probablement pas plus à moyen terme le centre industrialisé de l’Union que l’Italie du sud n’a rattrapé l’Italie du nord en 150 ans. Ou alors, il faudrait un miracle économique et politique… Après tout, on peut certes imaginer que, après avoir assimilé les « réformes structurelles » façon « Troïka », la Grèce devienne à grands coups de politique industrielle européenne façon Aglietta/Brand le premier État développé à zéro émission carbone, la « Silicon Valley » du XXIème siècle, le nouveau phare des Nations, mais bon… j’ai le vague sentiment que cela va être compliqué…
Comme on l’aura compris, l’Euro pour les auteurs est une monnaie mal construite (ce n’est pas un scoop!) (cf. chapitre 1, « Les antécédents de l’euro », p. 15-49, chapitre 5, « Quelle union politique pour la zone Euro? », p. 171-232), et, dans le fond, les ingénieurs du Traité de Maastricht ont conçu quelque chose d’encore plus dysfonctionnel que ce que le rapport Werner de 1970 envisageait (p.40-41). En effet, ce dernier avait bien vu qu’il fallait pour assurer durablement la stabilité des changes entre monnaies européennes aligner les politiques budgétaires des Etats, harmoniser la fiscalité du capital entre ces derniers, ainsi que les coûts et prestations des différents Etats-Providence, bref qu’il fallait beaucoup de transferts de souveraineté dans des domaines essentiels pour réussir le challenge de la stabilité des changes. Néanmoins, même si décidément, on est parti du mauvais pied (pour des raisons idéologiques selon les auteurs), rassurez-vous, bonnes gens, tout n’est pas perdu, un peu de volonté politique et de technique institutionnelle va nous sauver. Il suffit de créer un « Trésor européen », de coordonner les politiques économiques nationales en sortant de l’austérité budgétaire à marche forcée, de donner tout son rôle à une politique industrielle ragaillardie et verdie, et nous serons sauvés. Amen.
Face à tant de candeur de la part d’économistes distingués, je ne peux qu’exprimer mon désarroi. En effet, les auteurs semblent sincèrement croire que les choix politiques européens et nationaux résultent d’une fonction de « choix social ». Ils parlent pompeusement de nouveau « contrat social » européen à instaurer (cf. Conclusion, p. 291-294) : « Il ne saurait y avoir d’avancée institutionnelle capable de sauver la zone Euro sans un nouveau contrat social. (…) Il s’agit de refonder un contrat social qui ne peut être le retour à un contrat de redistribution. C’est un contrat de participation des citoyens à une transformation des modes de vie qui fait reculer l’inégalité en unissant étroitement l’emploi à la conservation de l’environnement dans les territoires » (p. 293). Ils font comme si la situation des années 1945-1975, d’équilibre capital/travail (« compromis fordiste »), si bien décrite par les « régulationnistes », devait se reproduire sous une forme nouvelle et participative à l’échelle continentale. Or, aujourd’hui, il n’existe plus une Union soviétique aux portes de l’Occident pour obliger à des compromis ceux qui mènent actuellement si visiblement le jeu. Pour l’instant, ce qu’on observe à la mi-2013, c’est plutôt un approfondissement des gains des gagnants de la période antérieure: le dernier Traité européen en date, les « réformes structurelles », les « dévaluations internes », le sauvetage des grandes banques systémiques par les Etats, etc., tout s’oriente vers une solution simple et élégante à la crise : les gagnants (Etats créditeurs, banques, consommateurs, épargnants, habitants du centre industriel, etc.) continueront à gagner, les perdants (Etats débiteurs, contribuables, salariés, habitants de la périphérie désindustrialisée) continueront à perdre. Et pour l’heure, les perdants ont la politesse de souffrir le plus souvent en silence, ou de ne pas trouver les moyens d’un renversement politique de la situation. That’s all folks. Circulez il n’y a rien à voir. La victoire probable d’Angela Merkel aux élections allemandes de septembre 2013 devrait constituer comme le dernier sceau de cette simple et élégante solution.
En effet, si l’approche d’Aglietta et Brand est sans doute correcte du point de vue économique, elle me parait particulièrement limitée du point de vue politique. Les auteurs se plaignent par exemple de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande qui a mis de fait dans les mains du Bundestag de nombreuses décisions d’envergure européenne (p. 185-188). Il faut rappeler que la Cour ne fait que défendre dans ses décisions l’idée que le peuple allemand par ses représentants n’a pas signé pour une « union de transferts » (qu’Aglietta et Brand appellent de leurs vœux, cf. p. 173), qu’il reste maître, via ses représentants, de son budget national, et qu’en pratique, la Cour constitutionnelle allemande n’a en fait rien bloqué du tout depuis 2010. (Cela m’étonnerait ainsi qu’elle donne entièrement raison dans son prochain jugement à la Bundesbank contre la BCE, là on rirait cinq minutes, mais bon ce sont des gentils garçons à Karlsruhe.) La Cour n’interdit pas d’aller au delà en terme d’intégration européenne, mais elle souligne qu’il faudra demander l’avis du peuple allemand si l’on veut aller vraiment plus loin. C’est tout. Cela me parait une attitude éminemment respectueuse du « contrat social » allemand, et dans le fond d’un sain réalisme.
Plus généralement, il me semble que le lecteur pourrait se demander quel sens peut avoir un tel livre, tout au moins dans ses propositions, qui cherche à proposer rien moins qu’un « New Deal pour l’Europe« , alors même qu’il n’est visiblement pas le fruit d’une concertation européenne. Par exemple, vu les difficultés à établir une politique européenne de l’énergie (pourtant déjà prévue dans le Traité de Rome et dans le Traité Euratom), je me demande si partir sur la piste environnementale n’est déjà pas en soi une erreur. L’Allemagne a fait le choix d’abandonner le nucléaire, et son partenaire principal dans l’Eurozone, la France, n’est même pas capable de fermer une vieille centrale nucléaire comme Fessenheim. Si l’on devait se lancer dans une forte politique industrielle européenne d’appui à l’investissement et à l’innovation, il faudrait peut-être déjà choisir de partir dans une ou plusieurs directions unanimement partagées.