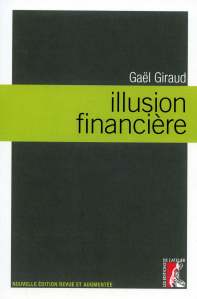Les affres financières de la Grèce sont en train de revenir par petites touches au premier plan de l’actualité. Le dernier livre en date de l’ancien Ministre de l’Économie du premier gouvernement Tsipras, l’économiste Yanis Vafoufakis, vient d’être traduit en français, et porte un titre plutôt énigmatique à première vue, Et les faibles subissent ce qu’ils doivent? Comment l’Europe de l’austérité menace la stabilité du monde (Paris : Les liens qui libèrent, 2016, 437 p.). Il permet de les resituer dans un plus vaste horizon, et de comprendre comment on en est arrivé là.
Les affres financières de la Grèce sont en train de revenir par petites touches au premier plan de l’actualité. Le dernier livre en date de l’ancien Ministre de l’Économie du premier gouvernement Tsipras, l’économiste Yanis Vafoufakis, vient d’être traduit en français, et porte un titre plutôt énigmatique à première vue, Et les faibles subissent ce qu’ils doivent? Comment l’Europe de l’austérité menace la stabilité du monde (Paris : Les liens qui libèrent, 2016, 437 p.). Il permet de les resituer dans un plus vaste horizon, et de comprendre comment on en est arrivé là.
J’avais lu le précédent ouvrage du même Y. Varoufakis traduit en français, Le Minotaure planétaire. L’ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial ( Paris : Éditions du cercle, 2015). La thématique des deux ouvrages se ressemble en fait très fortement. Dans les deux cas, il s’agit pour Y. Varoufakis d’expliquer que les maux contemporains de l’économie mondiale en général, et européenne en particulier, dépendent d’une maladie commencée dès le milieu des années 1960 lorsque les États-Unis ne furent plus capables de soutenir de leur puissance industrielle et commerciale le système de Bretton Woods. Pour le remplacer les dirigeants américains inventent, faute de mieux, entre 1971 (fin de la convertibilité-or du dollar) et 1979-1982 (hausse drastique du taux d’intérêt aux États-Unis) en passant par les deux chocs pétroliers successifs (1974 et 1979) ce que Y. Varoufakis appelle le « Minotaure », soit un mécanisme de recyclage des excédents qui permet aux États-Unis de maintenir leur suprématie politique sur le monde occidental en dépit même de leur affaiblissement industriel et commercial. En synthèse, les États-Unis continuent à accepter que leur marché intérieur reste grand ouvert aux pays exportateurs d’Europe (l’Allemagne par exemple ) et d’Asie (le Japon et la Corée du sud, puis la Chine, par exemple), et donc d’avoir en conséquence un fort déficit commercial avec ces derniers qu’ils payent en dollars, mais ils proposent en même temps, grâce à des taux d’intérêts élevés et grâce à leur marché financier immensément développé, à tous ceux qui génèrent ainsi des excédents en dollars de les placer aux États-Unis, en particulier en titres du Trésor américain, en pratique la réserve ultime de valeur à l’échelle mondiale, ce qui permet du coup à l’État américain d’avoir de manière presque permanente un déficit budgétaire conséquent. On retrouve le thème bien connu des « déficits jumeaux » de l’Amérique. Les autorités américaines l’ont voulu pour protéger un temps encore leur hégémonie sur le monde occidental. De fait, ce recyclage des excédents, via un secteur financier qui se développe aux États-Unis à due proportion, permettra d’assurer bon an mal an la croissance de l’économie mondiale jusqu’à la crise dite des « subprimes » en 2007-08. Les États-Unis jouent jusqu’à ce moment-là à la fois le rôle pour le monde de consommateur en dernier ressort et de placement en dernier ressort. Depuis lors, la situation est devenue fort incertaine : le « Minotaure » est mourant, mais rien ne semble vraiment le remplacer comme moteur de l’économie mondiale.
Pour ce qui est du côté européen de ce vaste tableau de l’économie mondiale que dresse ainsi l’auteur, Y. Varoufakis montre à quel point les Européens, depuis les années 1960, furent en fait incapables d’adopter des solutions cohérentes à ce problème du recyclage des excédents. Sur la foi de travaux historiques, il rappelle ainsi que l’abandon du système de Bretton Woods par le Président Nixon le 15 août 1971 a dépendu largement de la mauvaise volonté préalable des Européens (dont le Général De Gaulle) à soutenir le cours du dollar en onces d’or. Une fois confrontés au nouveau régime de changes flottants décidé à Washington, ces mêmes Européens n’ont cessé de chercher une solution leur permettant de maintenir une parité fixe entre leurs monnaies. Malheureusement pour eux, ils ont toujours choisi des solutions qui se sont révélés irréalistes à terme, parce qu’ils n’ont jamais voulu créer un système de recyclage politique des excédents. En effet, dans la mesure où il existe des pays à la fois plus forts industriellement et moins inflationnistes que les autres (en particulier, l’Allemagne à cause de la fixation anti-inflationniste de la Bundesbank et du compromis social-démocrate en vigueur outre-Rhin) et d’autre plus faibles industriellement et plus inflationnistes (en gros la France, l’Italie et le Royaume-Uni) un système de changes fixes se trouve pris entre deux maux, soit son éclatement à intervalles réguliers, soit une crise dépressive telle que la connaît la zone Euro depuis 2010. Des déficits commerciaux se creusent en effet inévitablement au profit du grand pays industriel peu inflationniste. Les pays déficitaires, dont la France, ont alors le choix entre dévaluer leur monnaie ou ne pas dévaluer. Si le pays concerné dévalue sa monnaie (au grand dam de ses politiciens et de ses classes supérieures), il regagne des parts de marché, mais il risque de connaître encore plus d’inflation. Pour ne pas dévaluer, la seule solution est de ralentir son économie, en augmentant ses taux d’intérêt et en adoptant des politiques d’austérité. C’est cette seconde solution qui l’a emportée au fil des années 1980-90, non sans crises d’ailleurs (comme celle de 1992), dans ce qui est devenu ensuite la zone Euro. Or l’existence de cette dernière, avec des parités irrévocables en son sein, provoque, d’une part, la possibilité pour la puissance industrielle centrale de conquérir désormais des parts de marché dans la périphérie sans risque de subite dévaluation et, d’autre part, l’apparition de ce fait de forts excédents d’épargne au sein du centre industriel. Ces excédents d’épargne, lié au fait qu’au centre on produit plus de valeur qu’on n’en consomme, sont recyclés par les banques du centre en placements, à la fois outre-Atlantique dans le « Minotaure » nord-américain et dans la périphérie de la zone Euro. Ces deux destinations des excédents d’épargne offrent l’avantage d’offrir avant 2007-08 des rendements très attractifs. Y. Varoufakis appelle ce mécanisme mis en oeuvre par les banques le « recyclage par beau temps ». Les épargnants (ménages et entreprises) du centre se laissent persuader par leurs banquiers de placer leur argent dans des lieux qui paraissent à la fois sans risque et rémunérateurs. Les placements en périphérie de la zone Euro se révèlent en effet particulièrement intéressants avant 2008 parce que la BCE fixe un taux d’intérêt unique lié plutôt à l’état des économies du centre de l’Eurozone, alors qu’en périphérie l’inflation reste plus élevée qu’au centre. Il est donc intéressant d’emprunter à ce taux unique, relativement faible, pour profiter de l’inflation de la périphérie, et d’obtenir ainsi un taux d’intérêt réel faible sur son emprunt. Ce dernier mécanisme fonctionne plutôt bien et accélère la croissance par le crédit à bas coût dans la périphérie de la zone Euro au début des années 2000 (en donnant lieu cependant à des bulles immobilières en Espagne ou en Irlande par exemple).
Malheureusement, tout ce bel échafaudage s’écroule entre 2008 et 2010, parce que les investisseurs comprennent d’un coup la nature de l’illusion de croissance qu’ils avaient eux-mêmes créée par leurs prêts. Et, en racontant les différents soubresauts de la crise européennes, Y. Varoufakis souligne toute la faiblesse de la zone Euro . En effet, une fois que le « recyclage par beau temps » s’est arrêté subitement, cette dernière a été incapable d’inventer un « recyclage politique » pour pallier les effets de cet arrêt. Au contraire, on en est revenu pour rééquilibrer les flux commerciaux à la solution classique pour éviter une dévaluation en régime de changes fixes, à savoir une austérité drastique dans les pays déficitaires de la périphérie (ce qu’on a appelé d’ailleurs la « dévaluation interne »), ce qui y a provoqué de profondes récessions et hausses du chômage. Surtout, les pays de la périphérie ont été forcés d’assumer seul la garantie des mauvais investissements faits chez eux par les banques du centre. Y. Varoufakis interprète ainsi le plan d’aide à la Grèce de mai 2010 comme un plan destiné à permettre aux banques français et allemandes de sortir sans trop de dommages de la nasse de leurs prêts hasardeux aux secteurs privé et public grecs, tout en faisant passer tout le fardeau aux contribuables grecs. Il se trouve que, comme le rapporte le journaliste de la Tribune Romaric Godin, un journal allemand, le Handelsblatt, vient de rendre compte d’une étude universitaire allemande qui dit exactement la même chose. R. Godin fait d’ailleurs remarquer que le fait même que cela soit dit dans un journal allemand lié au patronat est en soi une nouvelle – puisqu’en fait, par ailleurs, le reste du monde financier l’a fort bien su dès le début. Le tour de passe-passe de 2010 qui a constitué à charger les Grecs de tous les maux pour dissimuler les fautes des grandes banques du centre de l’Eurozone (françaises et allemandes surtout) commence donc, comme toute vérité historique dérangeante, à ressortir en pleine lumière, y compris dans le pays où le mensonge a été le plus fortement proclamé par les autorités et reprise par les médias. Le drame pour l’Union européenne est qu’un tel mensonge – avec les conséquences dramatiques qui s’en suivies pour des millions d’Européens (les Grecs et quelques autres) – met en cause toute sa légitimité. A ce train-là, il nous faudra bientôt une commission « Vérité et réconciliation » pour sauver l’Europe. Nous en sommes cependant fort loin, puisque les principaux responsables de ce mensonge sont encore au pouvoir en Allemagne et puisqu’ils continuent à insister pour « la Grèce paye ».
De fait, c’est sur la description des affaires européennes que la tonalité des deux livres diffère. Le second livre prend en effet une tonalité plus tragique, plus littéraire, parce que Y. Varoufakis en devenant Ministre de l’économie a vécu directement les apories de la zone Euro qu’il avait repérées auparavant dans les travaux historiques et par ses propres réflexions sur la crise de zone Euro. Du coup, la lecture de Et les faibles subissent ce qu’ils doivent? m’a fait penser au récit d’un maître zen qui aurait reçu pour la perfection de son éducation quelques bons coups de bâtons bien assénés par un autre maitre plus avancé sur le chemin de la sagesse, et qui aurait ainsi approfondi son état de clairvoyance.
L’absence de mécanisme européen de « recyclage politique des excédents » correspond ainsi à la prévalence des intérêts nationaux des pays dominants du centre de l’Eurozone, les fameux « pays créditeurs ». Le titre de l’ouvrage correspond à ce constat selon lequel que, derrière les institutions européennes qui officialisent l’égalité des États, tout le déroulement de la crise européenne depuis 2010 montre que la bonne vieille politique de puissance demeure intacte. Reprenant un passage de l’historien antique Thucydide, il souligne qu’un vainqueur peut imposer au vaincu des conditions de reddition honorables ou excessives. Or imposer une paix carthaginoise comme on dit mène en général à des suites fort désagréables au sein de l’État ainsi humilié, et finit en plus par relancer le conflit. Or, pour Y. Varoufakis, c’est tout à fait ce qu’ont fait les dirigeants européens depuis 2010 à l’encontre de son propre pays et des autres pays périphériques de l’Eurozone. Leur faire porter la responsabilité pleine et entière de la crise en lui donnant le nom fallacieux de « crise des dettes souveraines » sans jamais admettre les erreurs de jugement de leurs propres banques commerciales, moins encore celles de la BCE et encore moins les défauts évidents de construction de la zone Euro envisagé sous cet angle du recyclage des excédents.
Le propos de Y. Varoufakis souligne ainsi à longueur de pages l’ampleur des égoïsmes nationaux tout au long de la crise européenne et l’incapacité des dirigeants européens à comprendre la nécessité d’un mécanisme de recyclage politique des excédents pour pérenniser la zone Euro – alors même que les dirigeants américains essayent de leur signaler le problème. Même s’il précise explicitement que ce livre ne constitue pas un compte-rendu de son action comme Ministre de l’économie, il reste que Y. Varoufakis fournit au fil des chapitres de nombreux éléments tirés se son expérience ministérielle. Il souligne ainsi qu’il n’a jamais constaté de volonté de dialogue réel de la part des représentants des États créditeurs, du FMI ou de la BCE avec le premier gouvernement Tsipras. Il indique aussi que ce gouvernement n’a jamais été réellement aidé par celui de F. Hollande. Il a d’ailleurs la dent particulièrement dure tout au long de l’ouvrage à l’encontre des politiciens français. Ces derniers ont en effet dès le milieu des années 1960 vu l’établissement d’une monnaie unique européenne comme le moyen de s’emparer du pouvoir monétaire allemand. Or, à ce jeu-là, ils ont surtout réussi à être prisonnier d’une zone Euro où ils ne décident pas grand chose tant cette dernière obéit dans sa construction même aux desiderata des autorités allemandes, et où, en plus, l’Allemagne industrielle ne cesse de l’emporter sur la France en voie de désindustrialisation. Les autorités allemandes ne sont pas épargnées non plus. Décrivant le déroulement de la crise européenne, Y. Varoufakis rappelle par exemple comment le Premier Ministre italien, Mario Monti, a proposé en 2012 « l’Union bancaire » pour faire en sorte de séparer les comptes des États de ceux des banques situées sur leur territoire, et comment les autorités allemandes qui l’avaient accepté se sont efforcés ensuite de vider la proposition de sa substance et donc de son efficacité (p. 249-254). En fait, à suivre Y. Varoufakis, il n’y a vraiment rien à sauver dans l’attitude des responsables des pays créditeurs face à la crise.
Or ce constat l’amène – quelque peu paradoxalement à mon sens – à soutenir une réforme de l’Union européenne afin d’y faire émerger un intérêt général européen d’essence démocratique. Le livre comprend ainsi le « Manifeste pour démocratiser l’Europe » (p. 369-382), qui se trouve à la base du mouvement Diem25, qu’il a fondé cette année. Une de ses conclusions se trouve en effet être que cette politique de puissance et d’intérêts nationaux plus ou moins avouables, qui opère en particulier dans le cénacle restreint de l’Eurogroupe, n’aurait pas été possible si une discussion démocratique ouverte à tous les citoyens européens concernés avait eu lieu à l’occasion de la crise, si les décisions au sein de l’Eurogroupe et du Conseil européen avaient été prises publiquement. Il n’aurait pas été possible en particulier dans une discussion ouverte aux citoyens de faire payer aux habitants les plus désavantagés des pays en crise le sauvetage des banques du centre de l’Eurozone. En effet, on ne s’étonnera pas qu’en tant que citoyen grec, l’économiste Y. Varoufakis soit particulièrement choqué, pour ne pas dire plus, par le choix d’une austérité drastique qui a surtout frappé les classes populaires et les classes moyennes de son pays. Il l’est cependant tout autant pour les Irlandais, les Espagnols, etc. Il souligne à juste titre que le fonctionnement actuel de l’Union européenne revient à traiter très différemment les gens selon leur État d’appartenance. Une démocratie européenne au sens fort du terme n’aurait pas accepté de tels écarts de traitement. Y. Varoufakis s’illusionne peut-être sur la capacité des démocraties nationales ou des fédérations démocratiques à répartir équitablement les charges et les avantages, mais il reste que l’Union européenne a fait à peu prés tout ce qu’il fallait pour démontrer son iniquité sur ce point tout en se prévalant de sa « solidarité ».
Le raisonnement de Y. Varoufakis me parait cependant terriblement contradictoire – ou utopique si l’on veut. En effet, dans tout l’ouvrage, il ne cesse de montrer que, depuis le milieu des années 1960, le cours des événements ne dépend que de la poursuite d’intérêts nationaux où le fort écrase le faible, où le rusé berne le moins rusé, que certains intérêts, obsessions ou faiblesses s’avèrent à y regarder de prés bien plus permanents qu’on ne pourrait le penser a priori (par exemple si l’on observe le rôle de la Bundesbank au fil des décennies d’après-guerre) et qu’ils savent se dissimuler derrière l’idée européenne, que la bureaucratie de l’UE n’a aucune autre ambition que de développer son pouvoir. Or, en même temps qu’il établit ce florilège de bassesses, trahisons entre amis, vilénies et autres coups pendables entre alliés occidentaux, il prétend pouvoir rompre avec tout cela d’ici 2025. C’est en effet le sens de son mouvement Diem25.
Cette contradiction est particulièrement visible sur l’Euro. Il rend en effet hommage à Margaret Thatcher pour avoir vu dès le départ qu’il existait une incompatibilité entre la création de la zone Euro et le libre exercice de la démocratie nationale en son sein, il semble approuver les dirigeants britanniques qui ont réussi ensuite à ne pas tomber dans ce piège, et, en même temps, il ne propose pas de dissoudre cette même monnaie dont pourtant il passe tout un chapitre de son ouvrage à expliquer que son existence même éloigne au total les Européens les uns des autres (chapitre 6, Alchimistes à l’envers, p. 211-280). En fait, comme il l’a dit à plusieurs reprises dans la presse, Y. Varoufakis semble fermement convaincu que la dissolution de l’Euro aboutirait à une catastrophe économique d’une ampleur inimaginable et qu’il n’y a donc d’autre choix que de l’éviter. En conséquence, il ne reste qu’à bâtir d’urgence une démocratie européenne qui permettrait de supprimer les perversités actuelles que permet à certains puissants cette monnaie.
Comme politiste, je ne suis pas convaincu du tout qu’on puisse sortir de la « dépendance au sentier » qui marque l’Union européenne et la zone Euro. Tout cela ne s’est pas (mal) construit ainsi par hasard. Le fonctionnement de ces dernières correspondent à la fois à l’inexistence ou du moins à la faiblesse d’acteurs économiques ayant une base continentale (le « Grand capital » européen n’existe pas…contrairement au « Grand capital » allemand, français, grec, etc.) et à l’inexistence d’un électorat européen unifié. De fait, puisque toutes les élites nationales ne pensent qu’à leurs intérêts nationaux, qu’ils soient économiques ou électoraux, la lecture de Y. Varoufakis inciterait plutôt à plaider pour qu’on arrête là les frais. Il faudrait d’ailleurs ajouter aux propos de Y. Varoufakis que l’actuelle politique d’argent gratuit menée par la BCE et l’énervement qu’elle provoque désormais chez certaines autorités allemandes confirment que l’absence presque totale de vision un peu européenne chez certains acteurs clé.
Quoi qu’il en soit, le livre de Y. Varoufakis mérite vraiment d’être lu par la profondeur historique qu’il propose au lecteur. Quoi qu’il advienne ensuite à l’Union européenne et à la zone Euro, il restera comme un témoignage sur la manière dont un internationaliste a essayé de sauver l’idée européenne.