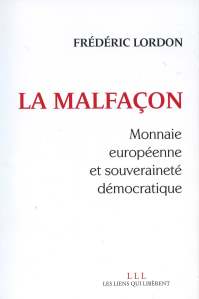 L’économiste (hyper-)critique Frédéric Lordon ne pouvait manquer de s’exprimer encore une fois sur la zone Euro. Son dernier livre, La Malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté européenne (Paris : Les liens qui libèrent [LLL], mars 2014, 296 p.) n’y va pas par quatre chemins : c’est clairement à un appel sans concession à en finir tout de suite avec la monnaie unique nommée Euro qu’on assiste.
L’économiste (hyper-)critique Frédéric Lordon ne pouvait manquer de s’exprimer encore une fois sur la zone Euro. Son dernier livre, La Malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté européenne (Paris : Les liens qui libèrent [LLL], mars 2014, 296 p.) n’y va pas par quatre chemins : c’est clairement à un appel sans concession à en finir tout de suite avec la monnaie unique nommée Euro qu’on assiste.
Le plaidoyer de l’économiste bien connu des lecteurs de son blog au sein du Monde diplomatique, la Pompe à Phynance, s’adresse exclusivement (cf. « Avant-propos. De quoi s’agit-il? », p.7-20, et chap. 8 « Ce que l’extrême droite ne nous prendra pas », p. 227-245) aux lecteurs qui se sentent de gauche, ou plutôt de la vraie gauche, pas de celle qui croit encore que le Parti socialiste serait de gauche. Il traite d’ailleurs ce dernier parti de « Droite complexée » pour l’opposer à la droite décomplexée de l’UMP, et lui réserve ces pires sarcasmes. Or, croyez-moi, F. Lordon s’y connaît en la matière, un vrai pamphlétaire à l’ancienne. Il se laisse d’ailleurs souvent emporter par sa verve, et cela lassera sans doute certains lecteurs pressés, cela nuit aussi probablement à la réception de ses idées. Pourtant, au delà de l’emballage un peu années 1880-1930 par moments, les idées exprimées tout au long de l’ouvrage s’avèrent simples et fortes.
Premièrement, l’Euro tel qu’il a été institué et toute la gouvernance économique qui va avec et qui s’est renforcé au cours de la crise économique est ontologiquement « de droite ». Il est bâti, d’une part, pour complaire aux obsessions ordo-libérales de la classe dirigeante allemande, d’autre part, pour rendre impossible toute autre politique économique que celle prônée par cette classe dirigeante allemande, y compris lorsqu’un autre électorat national que celui de l’Allemagne en aurait décidé autrement. En particulier, tout a été fait sciemment dès la conception de la future monnaie unique dans les années 1980-90 pour que ce soient les marchés financiers internationaux qui soient les arbitres des élégances des politiques économiques nationales. Par ailleurs, tous les choix faits pour résoudre la crise de la zone Euro depuis 2010 n’ont fait que renforcer institutionnellement cette tendance de départ. Et il y a en plus fort à parier que toute avancée ultérieure vers le « fédéralisme » (comme les Eurobonds par exemple, cf. p.50-57) ne se fera qu’à la condition expresse que la classe dirigeante allemande soit vraiment certaine que tous les pays continueront de s’aligner sur la one best way ordo-libérale préconisée.
Deuxièmement, selon F. Lordon, les Allemands – je préfèrerais pour ma part utiliser le terme de classes dirigeantes allemandes (au pluriel : économique, politique, académique, syndicale) – voient dans l’ordo-libéralisme et dans son obsession à l’encontre de l’inflation l’unique voie possible en matière d’organisation de l’économie européenne. Dans le chapitre 3, « De la domination allemande (ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas) », F. Lordon critique l’argument de la germanophobie utilisé à l’encontre de ceux qui, comme lui, pointent cette réalité de l’Allemagne contemporaine : toutes les grandes forces politiques adhérent au « cadre » de l’ordo-libéralisme, et cela ne risque pas de changer de sitôt. C’est une donnée indépassable à moyen terme de l’équation européenne. Une zone Euro qui comprend l’Allemagne comme partenaire principal ne peut donc qu’être ordo-libérale ou ne pas être.
Troisièmement, cet état de fait (un ordre économique européen ordo-libéral institué dans les Traités, et un pays dominant dont les élites croient dur comme fer à cet ordo-libéralisme qui leur convient bien par expérience depuis 1949) ne pourra jamais résoudre la crise économique en cours. Le livre a visiblement été rédigé au cours de l’année 2013 à un moment où aucune reprise économique n’apparaissait, mais avant qu’on commence à parler de déflation. Par ailleurs, F. Lordon souligne dans son chapitre 6, « Excursus. Un peuple européen est-il possible? » (p. 161-184), que tout saut fédéral (sans guillemets) est illusoire vu que personne n’en veut en réalité. Ce chapitre constitue d’ailleurs d’une lecture étrange pour un politiste. En effet, loin de se référer aux travaux de nos collègues sur le sujet, F. Lordon se bricole pour l’occasion une science politique des conditions préalables au fédéralisme à partir de références à son cher … Spinoza. (C’est un peu comme si je mettais à parler de politique industrielle en utilisant les travaux des physiocrates.)
De ces trois points, F. Lordon conclut, fort logiquement, que, pour défendre une vision « de gauche » de l’avenir de la société française, il faut absolument que la France sorte de la zone Euro, qu’il faut arrêter d’avoir peur à gauche d’une solution « nationale » (cf. chapitre 5, « La possibilité du national », p. 133-160). Cette sortie de la zone Euro ne serait pas économiquement la fin du monde, contrairement à ce que prétendent les européistes, mais plutôt la fin d’un certain capitalisme exclusivement financier. Toutefois, et c’est là que l’auteur fait preuve de son originalité, F. Lordon propose que cette sortie se fasse dans le cadre de la création d’une monnaie commune. Cette dernière serait une articulation entre le retour aux monnaies nationales, un système de change semi-fixe entre elles, et une monnaie commune pour assurer les échanges entre les pays membres de la nouvelle zone Euro et le reste du monde. Il expose son projet dans le chapitre 7, « Pour une monnaie commune (sans l’Allemagne – ou bien avec, mais pas à la francfortoise » (p.185-216), et il le précise dans une Annexe, « Ajustements de changes internes et externes en monnaie commune » (p.219-226). Ce projet voudrait faire en sorte que les taux de change entre monnaies de la nouvelle zone Euro s’ajustent à raison des déficits/excédents commerciaux des uns et des autres, sans laisser le soin de cet ajustement aux marchés des changes pour éviter spéculations et overshooting, en le confiant au bon soin des dirigeants européens eux-mêmes. Il est sans doute loin d’être absurde économiquement, mais je ne saurais dire à quel point je l’ai trouvé absurde politiquement! En effet, F. Lordon flingue lui-même à tout va tout au long de l’ouvrage l’irréalisme (ou le double jeu intéressé) de ceux qui prétendent faire advenir le fédéralisme européen dans les années qui viennent, au sens fort de fédéralisme comme aux États-Unis ou dans l’Union indienne. On peut lui renvoyer la politesse. En effet, dans l’hypothèse où la zone Euro viendrait à éclater, où chaque pays de la zone Euro retournerait à sa monnaie nationale, est-il bien sérieux de considérer l’hypothèse selon laquelle ces mêmes pays ou une partie d’entre eux se mettraient à se concerter gentiment sur les taux de changes entre leurs monnaies? La dissolution de la zone Euro ne pourra se faire que dans l’acrimonie mutuelle, et par des gouvernements qui souligneront que toutes les difficultés rencontrées par les populations viennent de la politique non-coopérative des voisins. De fait, l’Europe a déjà connu des négociations entre pays membres sur les taux de change, au temps déjà lointain certes des « montants compensatoires monétaires ». Pour conserver un marché commun agricole dans les années 1970-80 lors des dévaluations ou des réévaluations de monnaies de ses membres, la Communauté économique européenne jouait sur un système de taxes pour limiter l’impact de ces mouvements de changes sur ce dernier. Les négociations n’étaient dans mon souvenir pas très faciles. On imagine ce que seraient des négociations dans une Europe post-Zone Euro.
A mon humble avis, après la fin de la zone Euro, cela sera chacun pour soi et Dieu les changes flottants pour tous! Et cela d’autant plus, que, selon les ambitions « gauchistes » de F. Lordon, certains pays saisiraient le moment pour revenir sur la financiarisation du capitalisme, pour promouvoir un capitalisme plus centré sur la production nationale de biens et services réels avec un système bancaire (nationalisé) orienté vers l’appui à cette dernière. On aura donc déjà de la chance si, dans cette hypothèse de la fin de la zone Euro, les pays de l’ancienne zone Euro réussissent à maintenir la liberté de leurs échanges commerciaux. (Je suppose que Washington nous fera la leçon à nous Européens pour nous obliger à conserver le libre-échange entre nous, enfants dissipés ayant voulu jouer à créer des Etats-Unis d’Europe sans en avoir les capacités.)
C’est donc peu dire que j’ai été peu convaincu par l’hypothèse de la monnaie commune pour remplacer la monnaie unique. J’y vois surtout une ruse pour faire passer l’amère pilule de la fin de l’aventure européenne qu’incarne l’Euro auprès des socialistes et autres européistes de gauche à convaincre. Il ne faut pas désespérer « Boboland »! Une façon de se différentier aussi des positions du Front national. (La question ne se pose pas en effet pour un lecteur de droite, ce dernier se contentera d’un retour aux monnaies nationales et aux changes flottants.)
Par contre, je voudrais souligner pour finir cette recension à quel point l’idée reprise par F. Lordon chez K. Polanyi de la nécessité vitale pour la « société » de se défendre contre sa destruction par le « marché » est devenue aujourd’hui une hypothèse de travail centrale. En effet, telle qu’elle existe la zone Euro interdit de vivre (littéralement, cf. augmentation des taux de mortalité infantile en Grèce par exemple) aux peuples qui ne se reconnaissent pas dans ses coordonnées ordo-libérales – ou qui n’y arrivent pas tout simplement. F. Lordon a raison de se demander si le contrat social de délégation du pouvoir aux représentants peut survivre à la dévolution de ce même pouvoir aux seuls marchés financiers (« La finance, tiers intrus au contrat social », p.32-35). Pour F. Lordon, « La construction monétaire européenne est viciée à cœur. Elle est viciée par la neutralisation démocratique, dont elle a fait son principe sous l’ultimatum allemand. Qu’on ne puisse pas demander si la banque centrale doit être indépendante ou pas, si les dettes contractées à la suite des désastres de la finance privée doivent être remboursées ou pas, c’est une monstruosité politique que seul l’européisme élitaire ne pouvait apercevoir – mais qui tourmente tous les corps sociaux européens. Sauf l’Allemagne. Il n’y a qu’à l’Allemagne que ces interdictions n’apparaissent pas comme d’insupportables dénis de démocratie, car, aux choses sanctuarisées, le corps social allemand, pour l’heure, et pour encore un moment, adhère comme à des valeurs supérieures, méta-politiques, c’est à dire au delà de la politique et soustraite à la politique » (l’auteur souligne, p. 213-214).
J’aurais tendance à répondre face à cette hypothèse par une alternative : on peut imaginer que certains pays, peuples, sociétés finissent par connaître des réactions à la Polanyi – c’est peut-être déjà le cas en Hongrie par exemple : V. Orban, réélu hier pour quatre ans, ne prétend-il pas faire justement la politique de la Nation hongroise contre l’Europe et les marchés? -; on peut imaginer que, dans d’autres cas, les sociétés incapables, soit d’assumer l’ordo-libéralisme, soit de le combattre, se dissolvent simplement dans l’insignifiance, l’apathie, la dépression, l’inexistence sociale. Tout le pari de K. Polanyi/F. Lordon est qu’il existe un stade au delà duquel la « société » reprend ses droits sur le « marché ». Les voies concrètes et réalistes de cette réaction ne vont pas de soi, et après tout, les sociétés peuvent aussi mourir! Ou tout au moins une part de la société. Et sur ce point, la perception de F. Lordon du « corps social allemand » est peut-être aveugle et cruelle : l’Allemagne n’est-elle pas justement l’un des pays où les perdants ont perdu jusqu’au droit moral et jusqu’à l’énergie vitale de se plaindre de leur sort?
Ps. Ce matin, jeudi 17 avril 2014, F. Lordon a été invité à s’exprimer dans la « Matinale » de France-Inter. Ses propos m’ont paru plus percutants que dans son ouvrage. J’ai admiré sa façon de s’imposer sur un terrain médiatique qu’il sait particulièrement hostile à ses thèses. C’est en ce sens un modèle d’expression in partibus infedelium.
Par contre, son insistance sur le lien indissoluble entre le concept de souveraineté et celui de démocratie m’a paru à l’écoute excessif. Certes, il ne saurait à ce stade y avoir de démocratie effective sans qu’elle puisse influer sur les choix d’un État souverain, c’est-à-dire un peu maître de son destin interne et externe. Un État fantoche ne saurait être démocratique. Mais on peut très bien imaginer à l’inverse un État souverain sans aucune démocratie à l’intérieur. F. Lordon identifie la souveraineté à la démocratie, qu’il identifie elle-même à la délibération citoyenne. Or il me semble qu’on peut très bien voir la souveraineté comme décision libre de la part d’un « souverain » peu ou pas du tout démocratique. L’exemple typique de ce genre de souveraineté nous est donné dans le monde contemporain par la Russie, l’Arabie saoudite, la Chine populaire, l’Iran ou la Corée du Nord. F. Lordon reconnait d’ailleurs implicitement lui-même ce fait puisqu’il distingue « souverainisme de droite » (autocratique) et « souverainisme de gauche » (démocratique), mais il voudrait que la vraie et sainte souveraineté soit uniquement celle de la Nation à la manière de 1789. Elle peut être aussi celle du Sacre de l’Empereur des Français!

A te lire, je ne serai pas surpris par cette lecture de Lordon si je la fais, une bonne analyse des faits politico-économiques, mais viciée par son désir pamphlétaire, selon tes mots, ou par un besoin impérieux de lumière médiatique et de valorisation de l’égo, une hypothèse parmi d’autres. Et des solutions bricolées, bon exemple du taux de change fixe réglé à l’amiable par des élites qui seront surement ravies de passer autant de temps avec leurs nouveaux ennemis.
Bref, je me demande, et c’est une question large, si une partie de la solution à ce problème élitiste-ordo-libéral-financiarisé du projet politique européen est la reconstruction d’un rapport de force sur l’axe élites globalisées/ non-élites nationales plutôt que sur l’axe gauche droite (je précise que ce n’est pas mon idée mais celle de Streeck et Schaeffer dans Politics in the age of austerirty). L’ouvrage aborde-t-il cette question?
En gros, comme l’alternance gauche/droite gouvernementale ne veut plus dire grand chose et que l’armateur grec de droite décomplexée et le financier socio-démocrate allemand auront plus en commun entre eux qu’avec leurs compatriotes grecs et allemands, le premier effort ne serait-il pas de reconstruire une pensée et un combat politique en dehors de l’axe gauche/droite national traditionnel?
Ensuite, comment le faire autrement qu’avec des hippies dans les arbres (ou sur Wall street) dont la majeure partie des débats tournent autour du fait est ce que ‘il faut applaudir ou tourner les mains en AG, c’est une vraie question….
@clementfontan: j’aurais dû le préciser : F. Lordon ne croit en aucune manière à une lutte transnationale ou à une reconstruction d’autre chose qu’une lutte nationale entre les deux droites alliées (la complexée et la décomplexée) contre la vraie gauche dont il se fait le porte-parole. Il dit même à un moment que les manifestations transnationales à Bruxelles n’existent pas – ce que j’aurais dû relever tant c’est inexact. Il est clair que, pour lui, la solution, comme dirait Staline, c’est le socialisme dans un seul pays par éclatement de la zone Euro pour commencer, et la révolution mondiale ensuite si possible! Ce choix correspond pour lui à une question de délai : si l’on attend qu’une opposition transeuropéenne élites/masses prenne tournure, on risque d’attendre longtemps. Il voit aussi la concurrence terrible que fait le Front national(-socialiste) de M. Le Pen à son projet de sortie par la porte de gauche de la zone Euro. Il n’a pas envie de voir une sortie par la droite de cette dernière. C’est d’ailleurs à mon avis ce qui travaille beaucoup de gens qui pensent à la gauche de la gauche. L’Euro va mal finir, et la gauche avec…
Juste une question : comment expliquer l’entrée de la Lettonie dans l’euro ? Les Lettons sont-ils candidats au suicide ? Sont-ils conscients des risques qu’ils prennent ? Que pensent-ils gagner ?
@vince38 : il me semble que même le journal Le Monde a informé ses lecteurs que la population lettone était très réticente selon les sondages à cette entrée dans la zone Euro, mais que la majorité de la classe politique était pour. A vrai dire, les Lettons ont déjà payé pour l’Euro, puisque, depuis 2008, la monnaie lettone a été arrimée à l’Euro, et que les Lettons ont dû accepter une violente « dévaluation interne » des revenus (salariaux). Résultat : les jeunes Lettons qui ont pu partir l’ont fait, et les autres ont serré les dents et payé leurs emprunts immobiliers. Les élites (lettones) du pays sont néo-libérales, et pensent qu’être dans l’Euro garantira pour l’éternité la stabilité des prix! Il y aussi la volonté de s’arrimer solidement à l’Union européenne par crainte (justifiée?) de l’ogre russe! On ne laisserait quand même pas envahir une partie de la zone Euro, on mourra donc pour Riga!
Puisqu’on parle réalisme politique, je signale qu’en Grèce la très grande majorité de la population s’accroche toujours à l’idée de maintenir le pays dans l’Euro. Et on parle là du pays qui a priori souffrirait le plus de son maintien dans la zone Euro. Bref, c’est pas gagné pour Lordon. En réalité, seule une minorité (les moins qualifiés) est la grande perdante de la mondialisation, pour le moment en tous cas. Cela se reflète dans l’offre politique, seule l’extrême-droite fait mine (mais reste ambigüe) de proposer cela. On est loin du scénario de Polanyi (qui valait pour une société dont la paysannerie et la classe ouvrière, soit l’écrasante majorité, souffraient de changements structurels que le libéralisme voulait hâter sans précaution aucune).
Et je m’étonne aussi, pour rester dans le réalisme politique, que Lordon ne mentionne pas ici l’influence des USA (dans l’article ci-dessus il n’y a aussi qu’une petite phrase qui en touche un mot). Or la construction européenne, c’est en grande partie un projet américain (on connait maintenant les liens atlantistes des Pères de l’Europe, etc). On imagine tout aussi mal les USA laisser l’UE se désagréger que de la laisser aux mains d’une Allemagne (voire d’un couple franco-allemand) qui ne serait plus sous leur contrôle.
Ici Lordon semble s’imaginer qu’un président français pourrait décider « comme ça » une sortie de l’Euro de la France, suite à une élection gagnée. C’est selon moi risible. Si certains s’imaginent que même une Marine Le Pen déciderait (comme promis?) une sortie de l’Euro, ils se leurrent grandement (façon Todd avec son « Hollandisme révolutionnaire », qui à l’époque m’avait effaré venant d’un esprit habituellement plus clairvoyant).
Bref, j’aime beaucoup Lordon et son style, mais tout ça me paraît très utopique, voire franchement fantaisiste. Il n’y a ni une volonté populaire (classes moyennes) favorable à une sortie de l’Euro, ni une volonté de ceux qui détiennent la plus grande part du pouvoir réel de décision (élites nationales, Washington). Mais si certains veulent rêver et garder l’illusion d’un Grand Soir (décaféiné)…
@ Mon Pseudo : vous avez raison pour la différence de sociétés concernées par l’idée de Polanyi. J’y ajouterais la forclusion de la violence. Les populations européennes sont désarmées, elles n’ont pas d’outils à leurs dispositions pour une telle révolte.
L’aspect géopolitique se discute : les économistes américains ont averti pour beaucoup des dangers de l’Euro avant sa création, e,t après tout, le monde capitaliste fonctionne très bien avec une pluralité de monnaie. Les États-Unis pourraient même voir disparaître l’Euro avec joie sous son aspect « monnaie de réserve » et « monnaie de compte des échanges internationaux » concurrente du dollar US. On pourrait donc imaginer une dissolution de l’Euro qui respecterait les critères du capitalisme néo-libéral globalisé sous hégémonie américaine. F. Lordon pense à autre chose bien sûr, mais il n’est pas dit que les États-Unis soient tellement inquiets d’une expérience socialiste française destiné de toute façon à leurs yeux à échouer.
@ Mon Pseudo : Pour assister à son séminaire, Lordon met en avant les contradictions dans la zone euro et qu’ils jugent insolubles. Il propose d’anticiper l’échec afin d’atterrir en douceur et essaye de donner des pistes pour se faire : à mon sens, il fait son job d’intellectuel. Sauf crise politique en France ou en Italie qui accélérait le processus, il table pour une fin de l’euro à un horizon de dix ans…
Ras le bol de ces leçons de vraie gauche; la vraie gauche c’est celle qui favorise la création de richesse, puis leur répartition ; Merkel est à gauche de Fidel. Dites moi où et quand la politique que vous appelez de vos voeux a été menée et avec quel succès.
@ oiseau moqueur : en l’occurrence, à propos de l’Euro, il se trouve que cette monnaie unique semble bien pour F. Lordon et quelques autres économistes plus à droite que lui ralentir la création de richesses; il n’est pas d’abord question de « socialiser l’économie », mais simplement de faire (mieux) fonctionner l’économie capitaliste actuelle. De fait, il n’est pas interdit de faire remarquer que la Suède se porte mieux que l’Eurozone…
Par ailleurs, le drame est que la répartition des fruits de la croissance ne va aucunement de soi. L’actuelle situation américaine est caricaturale : la croissance est repartie, MAIS elle profite essentiellement aux plus riches parmi les plus riches. Les « trickle down economics », cela ne fonctionne définitivement pas.
Bonjour et merci pour cette note de lecture, très instructive et illustrative des dadas actuels de Lordon (Spinoza à toutes les sauces…).
Je voulais profiter de ce livre et du thème abordé (l’Europe) pour déborder quelque peu du sujet. Concernant l’Europe, j’ai lu le livre d’A. Vauchez, évoqué plus bas, ainsi que l’ouvrage (incisif) de R. Salais, Le viol d’Europe, mais je n’y trouve pas totalement mon compte. Je me demandais donc s’il y avait un ou des livres qui permettai(en)t de faire un petit peu le tour du sujet (en couvrant les domaines sociologiques, historiques, économiques…) ? Certes l’Europe est un thème énorme, couvert par plusieurs disciplines, etc. mais pour faire un point relativement complet sur le sujet existe-t-il de quoi se « nourrir » (sans connaître d’indigestion) ?
Désolé si cette question fait un peu « débutant »…
@ Mat : de fait, le sujet européen est énorme, je vous conseillerais déjà pour avoir une vue d’ensemble, au moins sur le plan politique, d’aller voir le manuel d’Olivier Costa et Nathalie Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, deuxième édition, 2014. C’est un petit livre bien rempli qui coûte autour d’une dizaine d’euros, et qui me parait fort bien vu pour avoir des bases sur l’ensemble européen actuel. Les livres publiés par la Documentation française sur le sujet européen sont souvent aussi très bien faits.
@ madeleine : je ne doute pas que F. Lordon joue son rôle d’intellectuel qui explore des pistes.
Cependant, si l’Euro dure encore dix ans, cela voudra dire que nous serons dans un contexte fort différent d’aujourd’hui. Des réformes institutionnelles auront été faites au forceps, et l' »Etat de la zone euro » existera donc. En plus, V. Poutine va peut-être nous aider à nous réformer en ce sens…
Pas forcement, je crois que vous sous-estimez la capacité de résilience de la zone euro. Dans la mise en œuvre de la thérapie de choc, et celle-ci, une fois mise en route. Peut-être pas dix ans, d’accord ! mais quelques années encore…
Pingback: Lire, puis voter (ou pas) aux Européennes. | Bouillaud's Weblog - bloc-notes d'un politiste
Bonjour à tous,
Je suis étudiante et on m’a donné comme travail à lire le chapitre 6 « Excursus » de F.Lordon. Il s’agit simplement d’une synthèse à faire, mais j’aimerai que l’on m’éclaire quant à la partie des affects (à partir de la p 170). Je ne suis pas passionnée pour cette lecture, j’ai donc des difficultés à comprendre clairement ce qu’il veut dire par là.
Pourriez-vous m’aider svp ? Merci d’avance.
@florekijak : mes collègues sont cruels avec les étudiants… Le chapitre 6 consiste en un exercice d’application de la pensée de Spinoza sur le cas européen, pour essayer de voir si l’on peut imaginer que les Européens forment un seul peuple. En gros, en France, les Bretons, les Parisiens et les Alsaciens ont ressenti la même chose face aux attentats du 7-9 janvier 2015, ils sont unis par une émotion commune qui dépasse les émotions locales (puisque le fait se passe à Paris et pas à Brest ou Strasbourg), est-ce que cela serait possible entre les Finlandais et les Espagnols dans des circonstances semblables? Et même, est-ce possible en toute circonstance ou dans la plupart des circonstances, où il faut partager des émotions collectives ? Est-ce que les émotions « locales » l’emportent ou non sur les émotions « européennes »? Cela revient à se demander par exemple si les Allemands compatissent à la misère en Grèce. F. Lordon répond négativement. Toutefois, le problème est qu’il ne tient aucun compte de tous les travaux de la science politique sur la question de l’identité européenne! De mon point de vue, c’est du « pipi de chat », mais bien sûr, vous n’avez absolument pas le droit d’écrire cela dans un compte-rendu à visée universitaire. Il faut le dire plus élégamment : « ce chapitre ne tient aucunement compte des avancées de la science politique professionnelle pratiquée par ailleurs », et « s’appuie uniquement sur une utilisation de la pensée de Spinoza ».
Bon courage.